La nouvelle
est un outil privilégié du réalisme, puisqu’elle met en abyme une facette
essentielle du réel : la particularité. Si sa durée et son rythme sont à
la mesure de la chose représentée plus intense, le récit doit
cependant être manié par l’auteur de façon à s’organiser littérairement, demandant
que l’action soit unie, les actants restreints, et l’explicit abrupt. Tout le
génie de l’auteur sera donc, dans ce tuyau qui rapetisse et où l’eau prend de
la vitesse, de manier ces éléments et de concentrer la cohérence de l’histoire.
« Une
vendetta » fut écrite par Maupassant et publiée en 1883 dans un quotidien.
Participante du courant réaliste, elle met en œuvre divers procédés, plus ou
moins systématiques chez l’auteur, pour mettre en place la trame du récit.
 |
| Yvonne Jean-Haffen, XXe s., Bonifacio |
Une vendetta
La
veuve de Paolo Saverini habitait seule avec son fils une petite maison pauvre
sur les remparts de Bonifacio. La ville, bâtie sur une avancée de la montagne,
suspendue même par places au-dessus de la mer, regarde, par-dessus le détroit
hérissé d’écueils, la côte plus basse de la Sardaigne. À ses pieds, de l’autre
côté, la contournant presque entièrement, une coupure de la falaise, qui
ressemble à un gigantesque corridor, lui sert de port, amène jusqu’aux
premières maisons, après un long circuit entre deux murailles abruptes, les
petits bateaux pêcheurs italiens ou sardes, et, chaque quinzaine, le vieux
vapeur poussif qui fait le service d’Ajaccio.
Sur
la montagne blanche, le tas de maisons pose une tache plus blanche encore.
Elles ont l’air de nids d’oiseaux sauvages, accrochées ainsi sur ce roc,
dominant ce passage terrible où ne s’aventurent guère les navires. Le vent,
sans repos, fatigue la mer, fatigue la côte nue, rongée par lui à peine vêtue
d’herbe ; il s’engouffre dans le détroit, dont il ravage les deux bords.
Les traînées d’écume pâle, accrochées aux pointes noires des innombrables rocs
qui percent partout les vagues, ont l’air de lambeaux de toiles flottant et
palpitant à la surface de l’eau.
La
maison de la veuve Saverini, soudée au bord même de la falaise, ouvrait ses
trois fenêtres sur cet horizon sauvage et désolé.
Elle
vivait là, seule, avec son fils Antoine et leur chienne « Sémillante », grande bête maigre,
aux poils longs et rudes, de la race des gardeurs de troupeaux. Elle servait au
jeune homme pour chasser.
Un
soir, après une dispute, Antoine Saverini fut tué traîtreusement, d’un coup de
couteau, par Nicolas Ravolati, qui, la nuit même, gagna la Sardaigne.
Quand
la vieille mère reçut le corps de son enfant, que des passants lui
rapportèrent, elle ne pleura pas, mais elle demeura longtemps immobile à le
regarder ; puis, étendant sa main ridée sur le cadavre, elle lui promit la
vendetta. Elle ne voulut point qu’on restât avec elle, et elle s’enferma auprès
du corps avec la chienne, qui hurlait. Elle hurlait, cette bête, d’une façon
continue, debout au pied du lit, la tête tendue vers son maître, et la queue
serrée entre les pattes. Elle ne bougeait pas plus que la mère, qui, penchée
maintenant sur le corps, l’œil fixe, pleurait de grosses larmes muettes en le
contemplant.
Le
jeune homme, sur le dos, vêtu de sa veste de gros drap trouée et déchirée à la
poitrine, semblait dormir ; mais il avait du sang partout : sur la
chemise arrachée pour les premiers soins ; sur son gilet, sur sa culotte,
sur la face, sur les mains. Des caillots de sang s’étaient figés dans la barbe
et dans les cheveux.
La
vieille mère se mit à lui parler. Au bruit de cette voix, la chienne se tut.
—
Va, va, tu seras vengé, mon petit, mon garçon, mon pauvre enfant. Dors, dors,
tu seras vengé, entends-tu ? C’est la mère qui le promet ! Et elle
tient toujours sa parole, la mère, tu le sais bien.
Et
lentement elle se pencha vers lui, collant ses lèvres froides sur les lèvres
mortes.
Alors,
Sémillante se remit à gémir. Elle poussait une longue plainte monotone,
déchirante, horrible.
Elles
restèrent là, toutes les deux, la femme et la bête, jusqu’au matin.
Antoine
Saverini fut enterré le lendemain, et bientôt on ne parla plus de lui dans
Bonifacio.
∴
Il
n’avait laissé ni frère ni proches cousins. Aucun homme n’était là pour
poursuivre la vendetta. Seule, la mère y pensait, la vieille.
De
l’autre côté du détroit, elle voyait du matin au soir un point blanc sur la
côte. C’est un petit village sarde, Longosardo, où se réfugient les bandits
corses traqués de trop près. Ils peuplent presque seuls ce hameau, en face des
côtes de leur patrie, et ils attendent là le moment de revenir, de retourner au
maquis. C’est dans ce village, elle le savait, que s’était réfugié Nicolas
Ravolati.
Toute
seule, tout le long du jour, assise à sa fenêtre, elle regardait là-bas en
songeant à la vengeance. Comment ferait-elle sans personne, infirme, si près de
la mort ? Mais elle avait promis, elle avait juré sur le cadavre. Elle ne
pouvait oublier, elle ne pouvait attendre. Que ferait-elle ? Elle ne
dormait plus la nuit, elle n’avait plus ni repos ni apaisement, elle cherchait,
obstinée. La chienne, à ses pieds, sommeillait, et, parfois, levant la tête,
hurlait au loin. Depuis que son maître n’était plus là, elle hurlait souvent
ainsi, comme si elle l’eût appelé, comme si son âme de bête, inconsolable, eût
aussi gardé le souvenir que rien n’efface.
Or,
une nuit, comme Sémillante se remettait à gémir, la mère, tout à coup, eut une
idée, une idée de sauvage vindicatif et féroce. Elle la médita jusqu’au
matin ; puis, levée dès les approches du jour, elle se rendit à l’église.
Elle pria, prosternée sur le pavé, abattue devant Dieu, le suppliant de
l’aider, de la soutenir, de donner à son pauvre corps usé la force qu’il lui
fallait pour venger le fils.
Puis
elle rentra. Elle avait dans sa cour un ancien baril défoncé, qui recueillait
l’eau des gouttières ; elle le renversa, le vida, l’assujettit contre le
sol avec des pieux et des pierres ; puis elle enchaîna Sémillante à cette
niche, et elle rentra.
Elle
marchait maintenant, sans repos, dans sa chambre, l’œil fixé toujours sur la
côte de Sardaigne. Il était là-bas, l’assassin.
La
chienne, tout le jour et toute la nuit, hurla. La vieille, au matin, lui porta
de l’eau dans une jatte ; mais rien de plus : pas de soupe, pas de
pain.
La
journée encore s’écoula. Sémillante, exténuée, dormait. Le lendemain, elle
avait les yeux luisants, le poil hérissé, et elle tirait éperdument sur sa
chaîne.
La
vieille ne lui donna encore rien à manger. La bête, devenue furieuse, aboyait
d’une voix rauque. La nuit encore se passa.
Alors,
au jour levé, la mère Saverini alla chez le voisin, prier qu’on lui donnât deux
bottes de paille. Elle prit de vieilles hardes qu’avait portées autrefois son
mari, et les bourra de fourrage, pour simuler un corps humain.
Ayant
piqué un bâton dans le sol, devant la niche de Sémillante, elle noua dessus ce
mannequin, qui semblait ainsi se tenir debout. Puis elle figura la tête au
moyen d’un paquet de vieux linge.
La
chienne, surprise, regardait cet homme de paille, et se taisait, bien que
dévorée de faim.
Alors
la vieille alla acheter chez le charcutier un long morceau de boudin noir. Rentrée
chez elle, elle alluma un feu de bois dans sa cour, auprès de la niche, et fit
griller son boudin. Sémillante, affolée, bondissait, écumait, les yeux fixés
sur le gril, dont le fumet lui entrait au ventre.
Puis
la mère fit de cette bouillie fumante une cravate à l’homme de paille. Elle la
lui ficela longtemps autour du cou, comme pour la lui entrer dedans. Quand ce
fut fini, elle déchaîna la chienne.
D’un
saut formidable, la bête atteignit la gorge du mannequin, et, les pattes sur
les épaules, se mit à la déchirer. Elle retombait, un morceau de sa proie à la
gueule, puis s’élançait de nouveau, enfonçait ses crocs dans les cordes,
arrachait quelques parcelles de nourriture, retombait encore, et rebondissait,
acharnée. Elle enlevait le visage par grands coups de dents, mettait en
lambeaux le col entier.
La
vieille, immobile et muette, regardait, l’œil allumé. Puis elle renchaîna sa bête,
la fit encore jeûner deux jours, et recommença cet étrange exercice.
Pendant
trois mois, elle l’habitua à cette sorte de lutte, à ce repas conquis à coups
de crocs. Elle ne l’enchaînait plus maintenant, mais elle la lançait d’un geste
sur le mannequin.
Elle
lui avait appris à le déchirer, à le dévorer, sans même qu’aucune nourriture
fût cachée en sa gorge. Elle lui donnait ensuite, comme récompense, le boudin
grillé pour elle.
Dès
qu’elle apercevait l’homme, Sémillante frémissait, puis tournait les yeux vers
sa maîtresse, qui lui criait : « Va ! » d’une voix
sifflante, en levant le doigt.
∴
Quand
elle jugea le temps venu, la mère Saverini alla se confesser et communia un
dimanche matin, avec une ferveur extatique ; puis, ayant revêtu des habits
de mâle, semblable à un vieux pauvre déguenillé, elle fit marché avec un
pêcheur sarde, qui la conduisit, accompagnée de sa chienne, de l’autre côté du
détroit.
Elle
avait, dans un sac de toile, un grand morceau de boudin. Sémillante jeûnait
depuis deux jours. La vieille femme, à tout moment, lui faisait sentir la
nourriture odorante, et l’excitait.
Elles
entrèrent dans Longosardo. La Corse allait en boitillant. Elle se présenta chez
un boulanger et demanda la demeure de Nicolas Ravolati. Il avait repris son
ancien métier, celui de menuisier. Il travaillait seul au fond de sa boutique.
La
vieille poussa la porte et l’appela :
—
Hé ! Nicolas !
Il
se tourna ; alors, lâchant sa chienne, elle cria :
—
Va, va, dévore, dévore !
L’animal,
affolé, s’élança, saisit la gorge. L’homme étendit les bras, l’étreignit, roula
par terre. Pendant quelques secondes, il se tordit, battant le sol de ses
pieds ; puis il demeura immobile, pendant que Sémillante lui fouillait le
cou, qu’elle arrachait par lambeaux.
Deux
voisins, assis sur leur porte, se rappelèrent parfaitement avoir vu sortir un
vieux pauvre avec un chien noir efflanqué qui mangeait, tout en marchant,
quelque chose de brun que lui donnait son maître.
La
vieille, le soir, était rentrée chez elle. Elle dormit bien, cette nuit-là.
 |
| J.-B. Bassoul, XXe s., Bisinchi |
I. Les aspects de la nature
1. La situation
Bonifacio se trouve être au-delà du monde humain, ancré
dans un décor naturel. Mais nous sommes aussi à la frontière de la mort, comme l’attestent
le crime, l’âge de la femme, le lieu encore. L’auteur le marque expressément en
écrivant ce « passage terrible où ne s’aventurent guère les navires »,
ou ce « nids d’oiseaux sauvages ».
2. La mère et le fils
Nous
recentrant sur le personnage principal, nous voyons qu’il se décline selon au
moins deux perspectives, dont celle qui rend la femme mère. Remarquons surtout
que le personnage est référé au début comme « la veuve Saverini », et
qu’elle ne « devient » mère qu’à partir de l’instant ou son fils
Antoine est assassiné. Et dès la maturation de sa combine, tout en restant mère
elle devient la « vieille » : « Seule, la mère y pensait,
la vieille. »
3. L’animal
3. L’animal
La
chienne « Sémillante », en tant qu’animal (nature) est référée comme « animal »
une seule fois, lorsqu’elle saute à la gorge de l’homme. Mais lorsqu’elle
devient la complice de la mère, l’auteur l’animalise davantage : « les
yeux luisants, le poil hérissé, et elle tirait éperdument sur sa chaîne. »
II. Les aspects de la culture
1. Les valeurs d’église et de justice
La société est comme divisée en deux par le passage de mer
entre la Corse et la Sardaigne : d’un côté les justes, de l’autre, dans un
autre village, les criminels. Mais de manière bien plus intéressante, la veuve
se rend trois fois à l’église : la première pour l’enterrement, la seconde
suit son idée de vengeance, la dernière précède l’acte de vengeance. La distance
entre une justice humaine — et même des affinités sociales, « bientôt
on ne parla plus de lui dans Bonifacio », un voisin semble absent — et
divine est augmentée à la fois dans la scission entre Corse et Sardaigne (la
justice des humains en Corse ne ferait pas son travail), mais surtout pour
rapprocher l’être solitaire et en deuil à son envers divin.
2. La veuve
La mère est encore une fonction sociale, par rapport à la
famille, lieu d’intersection entre nature et culture. Mais l’usage du mot « veuve »,
outre d’appuyer sur le champ lexical de la mort, renvoie à la femme mariée par
l’église, par la communauté. Comme nous l’avons dit, elle ne l’est qu’avant la
mort de son fils.
3. La chienne
Si la chienne appartient à la nature comme animal, elle
reste néanmoins liée à une non-nature puisqu’elle est domestiquée. Dire sa race
veut encore dire sa valeur culturelle (« gardeurs de troupeaux) et son
usage personnel : « Elle servait au jeune homme pour chasser. »
III. L’intersection entre nature et culture
1. L’humanisation de l’animal
La
proximité entre Sémillante et la mère ne se borne pas aux besoins de la
domesticité de l’animal : « Elle vivait là, seule, avec son fils
Antoine et leur chienne Sémillante ».
Mais quand la mort du fils survient, la relation s’amplifie, comme le marque l’auteur :
« avec la chienne », « Elle ne bougeait pas plus que la mère »,
« toutes les deux, la femme et la bête ». L’attribution de caractères
plus ou moins humains est encore caractéristique de ce lien, par exemple les verbes
hurler, se taire, gémir, « elle poussait une plainte ». Plus encore, la
chienne aurait gardé elle aussi la souffrance : « Depuis que son
maître n’était plus là, elle hurlait souvent ainsi, comme si elle l’eût appelé,
comme si son âme de bête, inconsolable, eût aussi gardé le souvenir que rien
n’efface. »
Quand
vient l’idée d’en faire un instrument de vengeance, la relation alors prend ses
distances, la bête est enchaînée dehors et devient l’objet d’un dressage, au-delà
duquel cependant elle saurait participer puisqu’elle semble avoir une parenté
de sentiments avec la mère.
2. L’animalisation de l’humain
Inversement,
la mère est animalisée par plusieurs traits, jusqu’à la limite possible :
sa douleur de mère précisément. Voyant le corps de son fils, « elle ne
pleura pas », et bien vite promet la vengeance ; elle est bientôt
seule, sans soutien du côté humain malgré sa vieillesse : « Seule,
la mère y pensait, la vieille », elle était « si près de la mort ? »
La
proximité à la chienne est souvent frappante, dans le geste ou la voix
sifflante de la mère ; l’auteur la manifeste par un parallélisme
quelquefois : « Elle ne dormait plus la nuit, elle n’avait plus ni
repos ni apaisement, elle cherchait, obstinée. La chienne, à ses pieds, sommeillait,
et, parfois, levant la tête, hurlait au loin », ou encore : « l’œil
fixe », « la vieille, immobile et muette, regardait, l’œil allumé »,
que l’on comparera aux yeux — pluriels — de la chienne. Quand elle eut « une idée de sauvage
vindicatif et féroce », la naturalité comme resurgie des entrailles de l’homme
fait en même temps surface dans le texte.
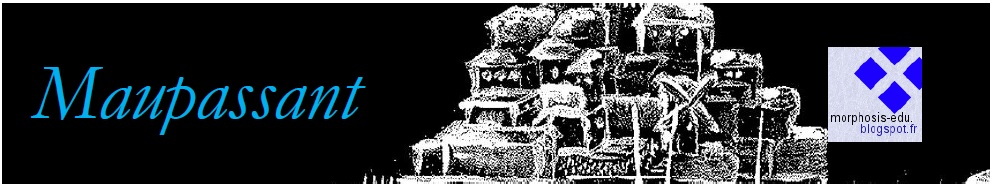

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire